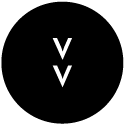2008
Sumida-gawa, un théâtre Nô
comme thème et comme partition d’une création contemporaine.
Par Valentine Verhaeghe
in actes du colloque, L’Écriture textuelle des théâtres d’Asie, Université de Franche-Comté, 2008
Nous proposons une réflexion sur l’expérience d’écriture d’une création contemporaine [1] occidentale, s’originant à la fois dans un nô et dans un corpus légué par les avant-gardes historiques en occident. Notre démarche de création s’inscrit dans une démarche transdisciplinaire, c’est avec une telle démarche que nous avons expérimenté le nô, l’inter-prétant ; situant notre création dans un in between, nous avons tenté de représenter quelques éléments formels et rigoureux du nô dans le dessin d’une partition aléatoire.
« Vous avez vu qu’il n’est pas facile de déchiffrer l’écriture avec les yeux mais notre homme déchiffre maintenant l’écriture avec ses plaies »
Franz KAFKA [2],
I. Le nô Sumida-gawa commémore :
La légende rapporte que l’enfant Umewaka dans sa douzième année, ayant été enlevé par un marchand d’enfants et entraîné de force vers les Provinces du Nord, fut abandonné au bord de la rivière et y mourut. Cela se passait en l’an 976 au Japon. Selon les sources du monastère Mokubo-ji à Tokyo, dès 977 et quasiment sans interruption, la date anniversaire de la mort de l’enfant – reconnu alors comme un Saint [3] – a été marquée par des rites religieux, essentiellement des réunions dites nenbutsu qui consistaient à vénérer le nom du bouddha Amida. [4]
Depuis 1967 la cérémonie a pris la forme de la récitation dans son intégralité d’un nô écrit au début du XVè siècle par Kanze Motomasa [5], fils aîné de Zeami, nô intitulé Sumida-gawa et toujours inscrit au répertoire. On assiste donc, dans le cas d’Umewaka-ki à l’utilisation d’une œuvre « profane » [6] dans un cadre religieux.
Le choix de la récitation du nô Sumida-gawa lors d’Umewaka-ki paraît tout à fait légitime. En effet, le nô retrace la fin du long voyage de la mère d’Umewaka devenue « folle » – c’est-à-dire en état de transe, de possession au sens chamanique – à la recherche de son fils disparu. La mère [7] arrive à l’embarcadère de la rivière Sumida où un bac permet de traverser le fleuve. C’est à bord du bac, lors du récit fait par le passeur [8] que la mère comprendra que l’enfant mort en cet endroit un an auparavant jour pour jour, et dont on prépare la cérémonie funéraire anniversaire, est le fils qu’elle cherche. La pièce s’achève sur un grand nenbutsu où la mère joindra sa voix à celle de la foule rassemblée là.
La manière dont ce nô participe de la commémoration d’un événement dramatique au bord de la rivière Sumida nous a touché. Nous pensons à ce qu’Hans Georg Gadamer entend par « l’ordre » dont témoigne une œuvre : le nô Sumida Gawa, par les éléments qu’il ordonne et structure en une constellation, apporte une nouvelle unité de sens, il tente une remise en ordre intellectuelle du monde :
« Peut-être que toutes les forces de mémoire et de sauvegarde qui portent la culture humaine, reposent-elles sur ce qui vient à notre rencontre de façon exemplaire dans l’activité de l’artiste et dans l’expérience de l’art. Peut-être reposent-elles sur l’harmonie et l’ordre que nous ne cessons de recréer dans ce qui tombe en ruines. » [9]
Pour justifier un statut d’autorité et d’authenticité accordé à l’œuvre écrite, Gadamer invoque le fait que la littérature transporte une intention générale de parole et un contenu d’universalité qui est « idéalité ». Référence platonicienne, l’idéalité du texte est ce qui, en lui, se restitue à chaque fois qu’on l’actualise. Par l’intermédiaire de la parole et du langage poétiques, le nô Sumida Gawa, porteur d’événement, permet une expérience particulière de sens et de vérité et notamment grâce à la temporalité spécifique du nô ; grâce aussi à une référence au langage poétique, rappelé, à la manière d’un étendard, dans le déroulement même du drame. Le Shité (la mère), en effet, en citant une œuvre littéraire déjà lue, invite au plaisir de la retrouver, d’y séjourner, comme pour l’approfondir sans cesse dans sa constellation de sens. Paul Valéry aussi reconnut cela, en comparant la parole poétique à la danse : à la différence d’une marche en ligne droite ayant pour but de signifier quelque chose, le poème est, une danse ne se rendant nulle part, accomplissant des courbes et des mouvements rythmés.
En dansant la Sumida, Julien Blaine et Valentine Verhaeghe, au bord de la rivière l’Arc, Ventabren, 2001. © photo Michel Collet.
II. Un événement intermédia :
Sumida-gawa, nô du XVè siècle, a été le point de départ d’une création contemporaine, ici, c’est-à-dire en occident pour un événement chorégraphique et intermédia. Le titre du nô, fait référence directement à la rivière (gawa) Sumida qui, aujourd’hui, suit son court dans la mégapole de Tokyo. Le contexte des rives du fleuve évoqué se révélait en miroir dans notre concept de « mise-en-danse » du paysage dans notre création chorégraphique, mais nous voudrions aussi apporter un éclairage sur la conception même de notre pièce contemporaine, dans son écriture notamment en regard au nô originel.
Nous avons accordé une place à la commémoration tout en sortant de la répétition. Nous avons tenté d’apporter dans une nouvelle proposition – avec une écriture d’aujourd’hui, en ayant à l’esprit le sens particulier que donne H.-G. Gadamer à la mimésis, qui serait jeu à partir du texte, c’est-à-dire une transmutation et non pas imitation. Il s’agissait pour nous lors d’une représentation de renvoyer au nô, non dans le dessein de lui ressembler, mais plutôt de faire exister quelque chose – un événement pour lui-même – à distance des modèles. Nous avons intitulé notre création En dansant la Sumida, la qualifiant comme événement plus que comme spectacle : une présentation unique, a en effet eu lieu sur les rives de la rivière l’Arc à Ventabren, non loin d’Aix-en-Provence un matin d’avril. (Fig.1) À ce moment, nous savions qu’une cérémonie avec la récitation du nô, avait lieu à Tokyo ce jour du 14 avril 2001.
Pour cette création, nous avions invité, Julien Blaine, poète et artiste et Viviane Duvergé, danseuse, qui développait alors une recherche à l’Institut national des langues et civilisations orientales, à Paris.
1. Espace et temps du récit / espace et temps de la création :
La recherche de Viviane Duvergé [10] nous ont conduit à préciser plusieurs relations entre l’histoire contée l’histoire littéraire et la référence au paysage. Ainsi, le fleuve évoqué dans le nô offre nombres d’éléments propres à la rêverie : son image géographique de large cours d’eau, à la fois généreux et dangereux, son statut administratif de frontière entre deux provinces et surtout sa valeur symbolique de bordure où un contact peut s’établir entre le monde des hommes et celui de l’au-delà. La qualité nostalgique du nô est certaine, et l’auteur, donne au récit une forme singulière : il insère à l’intérieur du nô, une citation, un bloc issu d’un conte de l’Ise-monogatari, une œuvre beaucoup plus ancienne. En effet, lorsque la mère interroge le passeur dans la barque, elle fait référence à la mémoire littéraire. Et cette référence prend une telle importance dans Sumida-gawa qu’il est difficile de goûter pleinement la pièce sans connaître ce bref passage de l’Ise, qui donne à la poésie, à la présence du poète, la force d’une machine à arrêter le temps :
« Ils allaient encore et encore.
Entre le pays de Musashi et le pays de Shimôsa
il y avait une très grande rivière.
On l’appelait Sumida-gawa. » »[11]
Cette présence du Conte de l’Ise au cœur du nô établit un parallèle entre le personnage de la mère folle et le poète Narihira auteur des Contes d’Ise. Car ce qui étonne en premier lieu, comme le montre Duvergé V., c’est la manière dont le conte de l’Ise est appelé. Il ne s’agit pas d’une citation. Le conte n’est pas évoqué mais invoqué [12]. Le récit poétique du nô correspond à cette parole de Christian Bobin :
« La poésie est une parole aimante : elle rassemble celui qui la prononce, elle le recueille dans la nudité de quelques mots. Ces mots – et avec eux le mystère d’une présence humaine – sont offerts à celui qui les entend, qui les reçoit. La poésie, en ce sens, c’est la communication absolue d’une personne à une autre : un partage sans reste, un échange sans perte. On ne peut pas mentir en poésie. On ne peut dire que le vrai et seulement le vrai. […] si on ment on sort de la poésie pour choir dans le langage coutumier, dans le mensonge habituel, dans la vie ordinaire, morte. »[13]
2. Créer une ouverture dans la logique de la narration :
Qu’est-ce que s’arracher à la vie ordinaire, morte, sinon justement entrer dans le jeu, dans la fête, dans la danse et, enfin, s’accorder un tout nouveau rapport au temps ? Nous avons élaboré l’écriture de notre création, en relevant cette forme de l’insère et du déport – proche du concept d’empiètement que nous avions développé dans d’autres créations chorégraphiques – mais dans sa forme abrupte, irruptive plus proche encore du collage, forme empruntée largement par les artistes depuis la moitié du XXè siècle. Le collage a cette particularité, en effet, de rompre avec la logique de la narration, avec la logique de la réalité telle que nous la construisons et de nous faire entrer de pleins pieds dans un mouvement imprévu, avec un télescopage d’éléments d’origine temporelle ou de qualité esthétique radicalement différents.
Vladimir Marinov et Monique Mandelier [14] ont montré les similitudes que présente le collage avec le travail du rêve. L’incongruité surprenante de la mise en scène est certainement à rapprocher aussi de l’extravagance du rêve au sujet duquel Freud écrit que l’interprétation ne pourra en épuiser l’approche et parle d’une surinterprétation (Uberdeutung) « il se peut qu’il y en ait encore une autre (interprétation) une surinterprétation du même rêve et qu’elle lui ait échappé » [15]. Comme le rêve, l’image est sans cesse équivoque, surgissement d’éléments mnésiques, agents de déformation, condensation… Face à l’image, avec sa puissance d’oubli, notre position n’est plus celle du sujet qui connaît et qui peut enfermer et réduire le sens dans sa connaissance : connaissance du texte, maîtrise du scénario en l’occurrence – elle nous renvoie à un travail de canevas d’associations, de caviardages, de condensations et de déplacements. Il nous faut alors poursuivre et retrouver le travail du poète, échapper au sens unique et montrer qu’il y a des possibles en reste.
Sur-interprétation, c’est en ce sens que nous avons expérimenté le nô : il s’est agi, pour cette création d’une esthétique gestuelle – en dansant La Sumida, d’insérer dans l’ordre du récit des poèmes de Julien Blaine et d’ouvrir un espace nomade, laissant place à l’indéterminé, en interaction avec le récit du nô et le texte de Viviane Duvergé. Interactions en prise avec l’ordre d’un paysage méditerranéen – très loin du paysage originel indiqué par la pièce – un paysage bien réel que des siècles de civilisation Méditerranéennes ont contribué à dessiner.
3. Translations : le nô vient comme portée d’une nouvelle structure, mise en forme et partition :
Il y a, dans le nô, une référence constante au paysage :
Kanze Motomasa l’auteur de ce nô a choisi pour titre de la pièce l’enveloppe géographique de l’action – la rivière Sumida. Comme l’a noté Viviane Duvergé [16] dans sa recherche, c’est en effet le fleuve qui
« instruit l’organisation spatiale et temporelle du nô, il en dessine les trois lieux et en scande les trois moments :
Sur la rive, où se mettent en place les vecteurs du drame.
Sur le fleuve, à bord du bac qui désigne un espace de transition où la crise se noue et prend un tour décisif.
Par-delà le fleuve, sur l’autre rive, métaphore de l’autre monde, où le drame se résout. »
Le paysage de la rivière Sumida apparaît saturé de sens. Les significations accumulées constituent un substrat émotionnel et poétique d’une étonnante densité qui pré-dispose ce lieu à porter les drames comme il avait su dès le Xe siècle porter le poème, dans l’Ise-monogatari (Contes d’Ise).
Dans Le Mythe de l’éternel retour, Mircéa Eliade donne un exemple de mythisation d’un drame par l’intervention d’une fée, et fait remarquer que si certains aspects d’une « vérité historique » sont repérables dans les poèmes épiques, cette « vérité » ne concerne presque jamais des personnages et des événements précis, mais des institutions, des coutumes, des paysages. Viviane Duvergé avance que la mythisation du drame d’Umewaka s’opère par la seule présence de la rivière. Celle-ci, en effet, prend place dans le drame comme personnage. Si l’on se réfère au paysage que crée la rivière, on observe que celui-ci a la capacité de contenir le drame, or c’est la fonction du mythe. La rivière permet que les choses soient « cernées ». Il y a un « bord », un repère physique.
En échos à cette puissante et fluide structure héraclitienne, nous avons « décampé », choisi une forme outdoors pour notre action comme l’ont fait avant nous nombre d’artistes au XXe siècle, tout en sortant du cadre de la scène nous avons renoncé à l’exhaustivité du texte, mais nous avons respecté le déroulement dans sa temporalité et notamment la structure en Jo Ha Kyu. Le cheminement, le dévidement du récit est apparu comme forme structurante, véritable fleuve recouvrant la rivière réelle. Il s’averra qu’il venait en portée – employant un terme de l’écriture musicale, nous avons attribué au récit le rôle d’une portée dans la composition de l’événement. Le nô vient en place de la rivière Sumida devenue image, le texte de Nô donne un fil à la partition où se mêlent les poèmes de julien Blaine et les improvisations gestuelles de la danseuse. Nous avons alors rendu possible la suspension de séquences gestuelles en fonction d’éléments imprévisibles – notamment la présence du public – et le jeu avec la respiration du texte, des textes – telles des langues exportées, le jeu avec une poésie contemporaine,
« qui capte le mot globalement – le mot objet – celui-ci déclanche dans le psychisme du « lecteur » une série illimitée d’échos sonores – puis d’échos de pensées. Alors le corps entier s’engouffre dans cette forêt d’échos » [17]
Pour Julien Blaine : le « poëme » comme il le proclame dans la pièce :
« EST UN ADVERBE DE LIEU.
UN ADVERBE PLUS OU MOiNS LONG
à MOINS QU’iL NE SOiT QU’
UN COMPLéMENT OU MiEUX QU’UN REFLET
DE CiRCONSTANCE.
CE QUi EST DiT EST FUTiLE.
CE N’EST PAS QUi JE SUis
QUi JE FUS
ET QUi JE SERAi
QUi éCRIT
MAiS L’EMPLACEMENT
DE L’êTRE
AU MOMENT Où IL éCRIT
Où IL A éCRIT
Où IL éCRIRA.
QUE JE FORMULE DE LA RéFLEXION,
DE L’ACTiON,
DE LA VOYANCE,
DE LA DESCRiPTiON
DU MOi
OU
DU EUX,
DE LA DESCRiPTiON
D’OBJET
OU
DE NATURE,
LES MOTS SONT CEUX DU CADASTRE.
AiNSi CHAQUE POèTE QUi NE PARLERAiT
QU’UNE LANGUE
EST EN FAiT CONFRONTé
AU FUR ET à MESURER DE SES DéPLACEMENTS
NE FUSSENT-iLS QUE DE QUELQUES MiLLiMèTRES
à DES LANGUES éTRANGèRES.
ET C’EST LE LiEU DU MOMENT
QUi DiCTE AU POèTE LE TEXTE
QU’iL NE PEUT DOMiNER. »[18]
Nous pouvons voir ici, que Julien Blaine accorde, non seulement sa valeur au mot, mais aussi à la visualité de l’écriture et au son, le poëmopéra – selon son expression – trouve une unité de sens, de visibilité et de son. Un vers « polymorphe » écrit Stéphane Mallarmé en 1897. Julien Blaine est poète sonore et visuel, il accorde un intérêt particulier au signe :
« Les signes graphiques qui ne sont pas compris dans l’étroit enclos de notre alphabet peuvent augmenter la puissance du texte, cela c’est déjà vu dans les enluminures médiévales jusqu’aux calligrammes explosifs du vingtième. (…) il ne s’agit pas d’un apport du texte au découpage ou à l’illustration mais de séries de découvertes qui permettent d’accéder à une unité laquelle peut-être dans sa perfection un nouveau cri poétique ».[19]
Les mots ont une sonorité irremplaçable, permettant la polysémie, ce que Gadamer appelle la « polyphonie du sens ». « Le poème crée un espace pour la force de gravitation des mots » [20]
Et pour poursuivre plus loin notre propos, en terre non repérée, la poésie sonore contemporaine a été conçue dans le but affirmé de briser des catégories :
« Le poète travaille maintenant objectivement une langue considérée comme matière et il crée (ou fabrique) des textes avec tous les éléments de cette langue : phrases, mots, lettres, syllabes, accents, articulations, souffles et avec les informations sémantiques et esthétiques fournies par ces éléments. Le poète considère la langue comme un univers autonome et utilise tous les moyens techniques de création, de multiplication, de diffusion. Il s’agit d’un élargissement considérable du champ poétique, c’est-à-dire d’une spatialisation dans la multiplication des possibilités de créations. » [21]
Et c’est dans cette ouverture que la poésie du geste rejoint l’écriture du poète, dans la matière sonore de la respiration, dans le double mouvement d’introversion puis d’extraversion du corps dans l’espace, jusqu’aux profondeurs même du ventre, le poète sonore partage les mouvements et les rythmes dans une commune expérience du corps avec le danseur.
Notre pratique de création a été essentiellement intermédia au sens où l’a définie l’artiste Fluxus Dick Higgins en 1966 dans un essai consacré au concept d’intermedia, texte publié dans The Something Else Newsletters [22]. Empruntant ce concept à un poète du XIXe siècle, Samuel Taylor Coleridge, Higgins est le premier à en montrer la portée. Dick Higgins décrit précisément l’intermedia comme un « travail de fusion conceptuelle » où l’interaction est forte, comme entre le visuel et le littéraire dans la poésie concrète ; à la différence du mixed media où chaque élément est reconnaissable aisément – musique, livret et mise en scène, par exemple dans l’opéra. Délaissant les références japonisantes, dans notre pièce En dansant la Sumida il était naturellement risqué de produire un tel assemblage, la distance temporelle et culturelle de notre pratique en art contemporain avec le nô étant considérable, mais cet assemblage intermedia-Sumida a eu plusieurs fonctions. Nous avons notamment remarqué que le nô renvoyait, non seulement le miroitement d’un récit mythique et d’une rivière à jamais disparue du réel mais probablement par le poignant et l’aridité dramatique de son texte, par sa forme, il venait faire démontage de l’apparence d’une « provencialité exotique » du paysage dans lequel nous étions et révélation de la construction de la parole et du geste soumis aux paradigmes de la contemporanéité des différents protagonistes, la danseuse, la récitante, le poète. Le récit du nô, probablement dans sa fonction liminaire renvoyait à distance, éloignait les faciles liaisons, les contiguïtés hasardées, faisait cadre, dans cette portion de nature et de temporalité. Face à ce nô, ou plutôt dans le flux de ce nô, nous pensons à ce beau texte d’Annah Arendt qui remarquait dans The Human Condition qu’en présence des autoportraits de vieillesse des maîtres nous pourrions saisir l’apparence de la disparition : « l’immensité du regard semble illuminer, dominer la chair qui se retire ».
1.Verhaeghe Valentine, Blaine Julien, Duvergé Viviane, En dansant la Sumida, pièce chorégraphique & poëmopéra, Ventabren, NèPE, 2005.
2.Kafka Franz, À la colonie pénitentiaire, in Un artiste de la faim, trad, C. David, Paris, Gallimard folio, 1948-1975, p.81.
3. Dans la tradition bouddhique : une réincarnation, un bodhisattva.
4. namu Amida butsu, « Hommage soit au Bouddha Amida »
5. Kanze Motomasa, (XVe) Sumida Gawa, traduction du japonais par P. Cossard, Bulletin de la Maison Franco-japonaise, 1946.
6. Les liens qui unissent le théâtre nô au bouddhisme sont étroits, tant pour le choix des thèmes traités que par l’esthétique.
7. Le rôle du shite est attribué à la mère.
8. Le rôle du waki est attribué au passeur.
9. Gadamer Hans-Georg, 1992, L’Actualité du beau, L’antiquité et l’art contemporain, textes choisis, traduits et présentés par Elfie Poulain, Paris, Alinéa, p. 127.
10. Duvergé Viviane, 2001, Le géographe et le poète, in En dansant la Sumida, op. cit.
11. Ariwara no Narihira (825 – 880) ) : Personnage de distinction, héros et auteur présumé d’un grand nombre des contes de l’Isemonogatari.
12. Duvergé Viviane, op. cit.
13. Bobin Christian, La merveille et l’obscur suivi de La parole vive, entretiens 1990-1994, Éditions la passe du vent, 1999, p30.
14. Marinov V, Mandelier M. Rêver, fantasmer, découper à travers la technique du collage, Soins Psychiatriques, n°162, avril 1994, dossier.
15. Freud S, (1914), L’interprétation des rêves, Paris, PUF; 1967, p 445.
16. Duvergé V. Le géographe et le poète, in En dansant la Sumida, op. cit.
17. Garnier Pierre, 1962, Manifeste pour une poésie nouvelle, visuelle et phonique, in Les Lettres, n°29.
18. Blaine Julien, PO.M N° 12945, in Bimot, huile, Nuit, les éditions Evidant, Tours 1990, repris dans En dansant la Sumida, op cit.
19. Blaine Julien, 1966, Pour en commencer avec le séméiotisme, in Garnier Pierre, Spatialisme et poésie concrète, Gallimard, Paris.
20. Gadamer Hans-Georg, 1991., L’Art de comprendre, Écrits II. Herméneutique et champs de l’expérience humaine, textes réunis par Pierre Fruchon et trad. par Isabelle Julien-Deygout, Philippe Forget, Pierre Fruchon, Jean Grondin et Jacques Schouwey, Paris, Aubier, p. 187.
21. Niikuni Seicihi et Garnier Pierre, (1966) Préface à Poèmes franco-japonais, repris dans Poésure et peintrie, Réunion des Musées Nationaux, Marseille, p 547.
22. Dick Higgins, (1966) Intermedia, Something Else Newsletter 1.